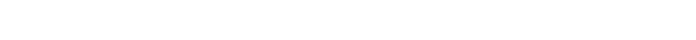Non Plus Ultra – Entretien avec Jordi Serrano, fondateur de Domestica Records

Avec un goût très sûr, Domestica exhume depuis plusieurs années maquettes, demos, cassettes ou disques rares, afin de publier des pépites, souvent inédites, de musique électronique et de new wave européenne, avec une attention particulière pour la scène espagnole. Tant pour leur qualité sonore que pour leur design original et soigné, les productions du label apparaissent comme un modèle d’artisanat discographique du XXIe siècle. Son créateur, Jordi Serrano, nous a reçu un matin de juillet dans son atelier de Sabadell, ville au passé industriel située dans la périphérie nord de Barcelone, pour parler de ses activités et de la scène synth pop et électronique espagnole des années 80.
Domestica a été créée en 2011 et compte déjà une cinquantaine de références. Quelles étaient tes motivations en débutant cette aventure ? Pourrais-tu résumer en quelques mots l’esthétique et la philosophie du label ?
Dans quelques jours, le 8 juillet, nous fêterons officiellement nos 5 ans. Et c’est vrai qu’il y a un certain bagage !
En fait, l’esthétique et la philosophie du label sont assez liées. Précisément, l’esthétique occupait une place importante dans mes motivations. Je ne voulais pas seulement créer un label qui soit authentique sur le plan musical et pouvoir récupérer des groupes dont personne ne se souciait alors. Je voulais ajouter à cela une esthétique et une philosophie de travail d’édition de disques très particulière, une identité de label très marquée. Ma motivation principale était de créer des pièces qui parlaient extérieurement de ce qu’il y a à l’intérieur, en maintenant un discours cohérent entre l’ensemble des références du label. J’ai fait des études de graphisme en pensant déjà que je commencerai cette aventure. Ce que je n’avais pas pensé, c’est que cela irait si loin. Enfin, si loin entre guillemets, parce que Domestica reste un très petit label. Mais la réponse des gens a effectivement été très bonne.
Une autre motivation, évidemment la plus importante, était la partie musicale parce que, comme je le disais, il y avait beaucoup de groupes d’ici, surtout d’ici… Finalement, au niveau international, il y a des yeux de tous les côtés. Quand tu travailles avec un groupe anglais, il se peut qu’un groupe américain l’ait remarqué. Mais en Espagne, il y avait tous ces projets : Interacción, Todotodo, Línea Vienesa, Funeraria Vergara, Terminal, Peña Wagneriana que personne n’osait sortir pour la plupart. Ou alors, si tu l’évoquais, on portait les mains à la tête et on te disait: « mais tu es fou ». Certaines personnes me l’ont dit quand j’ai commencé à parler du projet en 2010. Je me souviens alors d’avoir eu la sensation de me dire : « il faut le faire ».
Revenir sur l’histoire musicale du pays, sur ces groupes synth pop et électronique des années 80, te semblait donc important…
Oui, c’était important, surtout pour le montrer aux personnes qui ne l’avaient pas vécu. Ceux qui l’ont vécu s’intéressent encore sûrement aux groupes qui leur ont plu à l’époque. Mais pour les gens de ma génération – j’ai 33 ans -, disons les gens de 30, 40 ou 20 ans, c’est un son qui n’a pas perdu de sa pertinence avec le temps, qui continue d’être très intéressant et authentique. Mon idée était de montrer ce qui s’était fait à ce moment-là et d’ouvrir des portes en un sens. Il y a évidemment une composante nostalgique inhérente à tout cela puisque on parle d’un matériel réalisé il y a plus de trente ans. Mais il y a un peu de nostalgie dans l’écoute de n’importe quelle musique. Personnellement, je ne m’occupe pas de nostalgie. Je m’efforce de montrer quelque chose de nouveau, avec une nouvelle présentation, avec une qualité et une production. Quand je travaille sur un disque, je pense qu’il peut être destiné à quelqu’un de vingt ans comme à quelqu’un de soixante. Je veux ouvrir la découverte de ce son au maximum de gens possible.
J’ai l’impression que le catalogue de Domestica, avec tous les groupes que tu as cités, trace une image de la musique espagnole des années 80 assez éloignée de la version officielle. Il montre de façon très claire qu’il y avait alors des groupes qui utilisaient l’électronique et étaient assez sombres, qui sont demeurés méconnus mais dont le son parait aujourd’hui plus actuel.
C’est effectivement l’intention ; s’éloigner des clichés.
Comment qualifierais-tu la scène synth et électronique espagnole des années 80 ? Crois-tu qu’on puisse identifier différents courants ?
Personnellement, je ne l’ai pas vécue. La vision que j’en aie s’est forgée à partir de ce que m’ont raconté tous les artistes avec lesquels j’ai travaillé. Forcément, tu éprouves de la curiosité et tu leur demandes : comment faisiez-vous ? quels étaient vos moyens ? faisiez-vous des concerts ? comment la musique était-elle distribuée ? Tu glanes des impressions d’un peu tout le monde, puis tu assembles les pièces du puzzle et tu peux te faire une idée. Je dirais qu’il y avait de forts contrastes. Cela dépendait pas mal d’où tu étais et de ta débrouillardise au moment de faire circuler cette musique dans un cercle de gens qui pouvaient être intéressés ou non. Quand on parle de la musique très underground de l’époque, tout ce qui n’était pas à Madrid et ne disposait pas de l’attention de la presse, devait se faire par courrier. Tout était très lent, les gens ne pouvaient rien écouter préalablement. Tout relevait d’un contact très direct, de personne à personne.
C’est un héritage du punk…
Totalement. La philosophie de travail vient du punk. Je suis très ami avec Victor Marute, le bassiste de Terminal. Je travaille avec beaucoup de gens mais, lui, je peux le considérer comme un de mes amis. On se voit régulièrement, je vais manger chez lui… Un jour, il m’a dit une chose qui m’est restée: « quand ceux qui faisaient du punk ont commencé à jouer un peu mieux, ils ont voulu faire d’autres choses ». C’est à ce moment-là que la production et le son ont changé. Mais la façon de faire et la mentalité sincère, l’esprit, étaient les mêmes. Ce n’était plus un son strident et « je-joue-et-je-fais-ce-que-je-veux-parce-que-oui »; c’était déjà autre chose. Mais la manière de distribuer la musique, d’organiser les concerts et tout le reste, était exactement identique, je crois.
Dirais-tu qu’il existait une spécificité de la scène espagnole dans le contexte européen ?
Dans la scène espagnole, il n’y avait pas beaucoup de gens impliqués. C’est vrai qu’il y avait des petits labels belges, allemands, qui ponctuellement contactaient Esplendor Geométrico et d’autres projets. Tu peux trouver des cassettes très étranges pour ainsi dire, très limitées, faites avec une production très fragile, qui incorporent des groupes espagnols. Mais, en ce qui concerne la scène underground, il n’y avait pas beaucoup de connexion entre l’Espagne et le reste de l’Europe, en termes d’échanges. Il n’y avait pas tellement de mouvements d’artistes, ni d’ici vers l’extérieur, ni de l’extérieur vers ici. Ca coûtait un peu.
Les compilations mêlant artistes espagnols et internationaux, comme celles du label Auxilio de Cientos ou Domestic Sampler UMYU faite par Victor Nubla, étaient donc des exceptions ?
Auxilio de Cientos est une exception. Ca a été un miracle qu’apparaisse quelque chose comme ça à Grenade, publiant des groupes comme Twilight Ritual et des compilations comme Femirama avec des artistes comme Tara Cross et Ana [aka Ani Zinc : artiste sonore, membre du duo Diseño Corbusier, également connue pour son projet Neo Zelanda, co-fondatrice en 1983, avec Javier Marín, du label Auxilio de Cientos, ndlr]. Mais bon, ils passaient par le courrier, travaillaient par correspondance. Il y avait alors très peu d’acteurs qui créaient ce genre de liens. Il existait certes des scènes très actives et très créatives, mais elles étaient plus locales. Ca ressemblait encore à des bulles où tout se passait à l’intérieur. Maintenant, si cela nous semble peu, c’est aussi parce que nous comparons avec ce qui se passe aujourd’hui, depuis notre perspective actuelle, où il n’y a plus de frontières, où on distribue ici et là, et encore là…
Y a-t-il des groupes étrangers qui te semblent avoir marqué le son des groupes espagnols ? Qu’écoutaient-ils ?
Je me le demande aussi beaucoup. Tout le monde me parle de groupes très connus. En Espagne, trouver des disques, disons par exemple, de Cabaret Voltaire était impensable. Au mieux, tu pouvais trouver avec un peu de chance quelque chose de Kraftwerk. Nombreux étaient ceux qui allaient en Andorre ou en France pour acheter des disques et trouver ce genre de matériel. En fait, c’était très difficile. Quand la musique électronique est arrivée ici, quand elle a commencé à pénétrer la pop, la réaction a été, en général, le rejet. Il y avait bien entendu des groupes qui plaisaient. Mais bon, c’était Yazoo ou d’autres très connus qui arrivaient. Il s’agissait des quelques influences que certains de ces groupes pouvaient avoir. On parle évidemment de la veine plutôt commerciale. Si on considère le courant plus industriel et expérimental…
… qui s’est développé un peu plus tard dans les années 80, particulièrement à Barcelone où des groupes évoluaient vers le bruitisme ou l’EBM (Electronic Body Music) ?
L’EBM, ça a été un peu après. Mais c’est effectivement curieux qu’il y ait eu autant de production expérimentale ou bruitiste, de travail sur les textures sonores, en Espagne. On ne parle pas énormément de Macromassa [groupe à géométrie variable, pionnier et inclassable, fondé en 1976 à Barcelone, par les musiciens Juan Crek et Victor Nubla, ndlr] qui, dans les années 1976-77, créait déjà avec ce concept musical. Qu’on l’apprécie plus ou moins, le groupe disposait déjà de cette philosophie de travail. Quelles pouvaient être leurs influences ? Eh bien, j’imagine que Conrad Schnitzler, Tangerine Dream et la scène krautrock. Ensuite, tout cela a progressivement évolué et dérivé. A mesure que la technologie introduisait de nouveaux instruments, le son notamment s’est transformé.
Mais le manque de références peut aussi être une chance, en un sens. Ce qu’il y avait à Barcelone, ce n’était pas tant une tradition de musique expérimentale que des moyens supérieurs et un meilleur accès aux salles. Il était plus facile de créer des cercles de contacts avec des artistes similaires et qu’apparaissent des labels comme Ddomèstic, qui a publié cette compilation. Bien que Ddomèstic ne se soit pas distingué non plus par une ligne très expérimentale, allant vers la pop, le punk, un peu de tout… Ils ont sorti des perles : Ultratruita, Distrito 5, le deuxième single de Terminal. Mais, eux, c’était déjà autre chose. C’était des Talking Heads, mais à l’espagnole.
Y a-t-il des artistes de l’époque encore en activité ou qui te paraissent avoir développé des oeuvres intéressantes au fil des années ?
S’il y en a qui continuent et ne s’arrêtent pas ? Macromassa ne s’est pas arrêté. En fait, c’est étrange, mais la plupart ont abandonné. C’est vrai qu’il y a quelques groupes connus comme Aviador Dro ou Esplendor Geométrico qui sont toujours là. Il semblait qu’Oviformia SCI allait se reformer aussi. Mais si ces groupes reviennent, c’est parce qu’ils voient qu’un intérêt pour cette musique a surgi aujourd’hui. Toujours est-il que ceux qui ont poursuivi n’ont pas été nombreux. Autoplex par exemple, c’est-à-dire Francesc Beltran, n’a cessé de faire de la musique. Il a été dans mille projets différents et a produit des choses très variées. Mais, si on parle de maintenir les projets initiaux, alors extrêmement peu l’ont fait. Très peu ont survécu ; ce qui est normal puisque c’était très difficile. N’oublions pas qu’à ce moment-là, personne ne s’intéressait à eux ! Plus de gens s’y intéressent maintenant, je crois, même si c’était plus vivant à l’époque, quand ils faisaient des concerts, souvent des concerts de 20 à 30 personnes d’ailleurs. On parle de cette veine plus underground, de ces groupes qui essayaient de créer quelque chose d’électronique, de différent, comme Kremlyn ou Autoplex, qui était un vrai bijou.
Peux-tu citer une référence de ton catalogue qui te semble essentielle ou dont tu te sentes particulièrement fier ?
Il y en a tellement, y compris des étrangères : Night Moves ou Modern Art, qui a été la première référence Domestica. Mais, si je ne devais en retenir qu’une, pour des raisons esthétiques autant que musicales, je dirais le premier volume de la compilation Non Plus Ultra. Parce qu’il y a une ligne esthétique très marquée, et aussi parce que c’est le projet qui m’a le plus encouragé à monter le label et qui m’a procuré le plus d’énergie au moment de lancer le projet. Il y en aurait beaucoup d’autres, mais cette compilation a été en quelque sorte le vrai point de départ du label.
J’ai l’impression que tu entres dans une nouvelle phase avec Domestica, en publiant des cassettes et plus de musique internationale. Quelles sont aujourd’hui tes objectifs pour le label ?
Il n’y a rien de prémédité ; ce sont simplement des phases. Il n’y a pas de volonté de ma part de changer le label. En ce moment, je travaille par exemple avec plusieurs groupes espagnols. J’ai éprouvé récemment la nécessité et l’envie de travailler avec des groupes contemporains. On a sorti quelques projets de Barcelone ou nationaux qu’on avait envie de soutenir comme Màquina Total et Pola Tog. Sincèrement, ça a été très amusant, notamment pour relâcher un peu le rythme de production de disques très soutenu que l’on maintenait ces dernières années. Ca nous a aussi permis d’avoir davantage de contacts directs avec les gens, d’organiser un concert et une fête avec mon collègue d’atelier. C’est un peu de l’oxygène. J’ai aussi sorti un groupe anglais, qui est une réedition, et Cult Club qui est un groupe actuel. Mais le fait que je ne sorte plus tellement de matériel d’ici depuis un certain temps est une pure coïncidence. Parce qu’on continue à travailler… Actuellement, je prépare justement le disque d’un groupe qui est de Madrid et des années 80. Mais c’est encore un secret.
Propos recueillis le 6 juillet 2016 à Sabadell.
A l’occasion du 5e anniversaire de Domestica, Jordi Serrano a concocté une playlist parcourant l’ensemble du catalogue du label. L’écouter ici